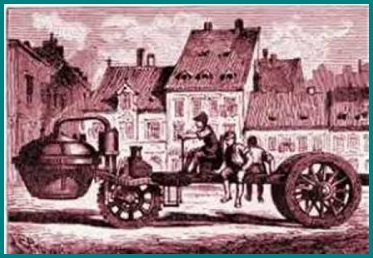LA PREHISTOIRE DE L'AUTOMOBILE
LA PREHISTOIRE DE L'AUTOMOBILE

Dernière mise à jour : 05/05/2010
Le Fardier de Cugnot
Nicolas Joseph Cugnot (1725-1805)

Nicolas-Joseph Cugnot est né le 25 septembre 1725 à Voigt (Void), entre Bar-le-Duc et Nancy, dans une
Lorraine encore autrichienne. Il construira le Fardier, considéré comme le premier véhicule roulant motorisé par une force
motrice non animale.
Les années 1760
En 1760, le principe du moteur à vapeur est adopté et ces derniers sont principalement destinés à la navigation
et aux les chemins de fer. L'évolution de ces modes de transport vont n'avoir de cesse de progresser.
Mais cela ne représente rien par rapport à ce qui va suivre : l'automobile.
L'idée d'un véhicule terrestre qui ne
nécessiterait plus la force humaine ou animale pour avancer est encore loin
d'être imaginable à l'époque. Pourtant, dans l'esprit de certains, cette pensée
va devenir une obsession et quelques chercheurs européens vont s'atteler à
cette tâche. Malgré certains avis contraire, on peut considérer que le
véritable inventeur de l'automobile est français, les essais précédents n'étant
que des modèles réduits, comme celui de Ferdinand Verbiest. Nicolas-Joseph
Cugnot, ingénieur militaire, déposera en 1769 le brevet d'un premier engin
mécanique, certes de grande taille, mais capable de rouler sans faire appel à
aucune force animale ou humaine, une première dans l'histoire de l'humanité. Il
semblerait que la première utilisation du fruit de ses recherches se soit
effectuée dans la cour de l'Arsenal de Paris en 1769, mais qu'il a construit son
engin bien avant. Comme vous le verrez, l'histoire est bien compliquée, et toujours pas
élucidée. Voyons cela plus en détail !
1763 - 1767
Né en Lorraine autrichienne, Nicolas-Joseph, fils de cultivateurs,
poursuit des études classiques et entre à l'Ecole du Corps Royal du Génie à Mézière. Lorsque Ferdinand III, duc de Lorraine,
quittera le pays pour suivre son épouse Marie-Thérèse de Habsbourg, reine de Hongrie et de Bohème, archiduchesse souveraine
d'Autriche, Cugnot le suivra. Lorsque la guerre de succession se déclencha en 1744, toute l'Europe est engagée.
En 1748, le jeune ingénieur militaire Cugnot s'engage dans l'armée autrichienne et a pour supérieur le Général de Gribeauval,
célèbre pour avoir été le créateur d'une artillerie modernisée. Gribeauval est à l'époque en relation avec l'ambassadeur de France
à Vienne, François de Choiseul. Les deux hommes s'intéressent de près à l'évolution de la technique et
suivent de près la première révolution industrielle britannique. En 1763, Cugnot est toujours au service de l'impératrice
Marie Thérèse d'Autriche, en guerre comme la France contre la Prusse (guerre de sept ans). Il est en Allemagne
lorsque le traité de paix est signé. Cugnot quitte l'armée, passe quelques temps en Belgique avant de rejoindre Paris
où il débute ses premières études. C'est en 1766, année ou la Lorraine redevient française, qu'il écrira un ouvrage sur
l'Art militaire ancien et nouveau ainsi qu'une une Théorie de la fortification. Il travaille également sur
un véhicule destiné à remplacer les attelages de chevaux pour tirer les canons de l'artillerie en campagne.
1769 : Le premier Fardier de Cugnot
Selon des écrits, ou plutôt un mémoire du
lieutenant général des Armées du Roy, Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval
(1715-1789), adressé le 2 juillet 1771 au Ministre de la Guerre le marquis de
Monteynard, Cugnot, futur ingénieur de l'empereur, aurait conçu son projet de machine à vapeur pour la traction
des canons dès 1767. Mais cela reste à confirmer. Le fait que Gribeauval en
parle avant la présentation au Duc de Choiseul prouverait que ce dernier a
effectivement déjà vu le jour. Comme on l'a vu, Gribeauval est très ouvert au
modernisme et suit de près les travaux de Cugnot.
C'est en 1769 qu'un officier ingénieur suisse, Monsieur
de Planta, présente au Duc de Choiseul, ministre du roi Louis XV, plusieurs
inventions dont une voiture mue par l'effet de la vapeur d'eau produite par le
feu. Dans l'assistance, le général de Gribeauval évoque alors le chariot de Nicolas-Joseph Cugnot.
Intéressé par la nouvelle, Choiseul, qui fait confiance à son ami de Gribeauval,
délègue l'ingénieur Planta présent pour aller examiner cet engin de plus près, l'ingénieur étant,
à son avis, le plus apte à faire un descriptif détaillé et crédible de l'engin.
Devant la maquette (énorme) du chariot de Cugnot, de Planta réalise que
le projet est plus avancé que le sien, et, beau joueur, se retire tout en
faisant état de sa visite au duc de Choiseul.
Ce dernier donne alors l'ordre à Gribeauval et à Cugnot de construire ce chariot, en plus
petit et au frais du roi. Ainsi va naître le premier "Fardier"
qui doit faire ses premiers essais dès octobre 1769 à Paris devant le ministre
Choiseul, le général de Gribeauval et diverses personnalités. A
cette époque, le véhicule est prévu pour le transport de lourdes charges
ou de fardeaux, et destiné à remplacer les attelages de l'Artillerie en
campagne.
Le 23 octobre 1769, Bachaumont, le chroniqueur militaire de Louis XV, notait
dans ses "mémoires secrets" les faits suivants (confirmant les essais
d'octobre) :"On a fait ces jours derniers l'épreuve
d'une machine singulière qui, adaptée à un chariot, devait lui faire parcourir
l'espace de 2 lieues en une heure, sans chevaux ; mais l'évènement n'a pas
répondu à ce qu'on promettait : elle n'a avancé que d'un quart de lieue en
soixante minutes. Cette expérience s'est faite en présence de M. de Gribeauval,
lieutenant général, à l'arsenal ...".
Toujours d'après les écrits, le Fardier de Cugnot a réussit les premiers test. Cependant,
la grandeur de la chaudière n'était pas proportionnée au volume des pompes (nom qu'on donnait aux cylindres). L'engin
fonctionnait pendant 12 à 15 minutes et il fallait la laisser reposer le temps de laisser la vapeur remonter en pression.
D'autres essais eurent lieu en novembre et malgré les défauts de la machine, cet essai fut jugé satisfaisant et une
présentation devant le roi est envisagée en début d'année 1770.
Le 1er décembre 1769, le sieur Bachaumont donnait sur les essais de cette "machine" les précisions suivantes
:"La machine pour faire aller un chariot
sans chevaux est de M. de Gribeauval ; on en a réitéré dernièrement l'expérience
avec plus de succès, mais pas encore avec tout celui qu'il y a lieu de s'en
promettre : il est question de la perfectionner. La machine est une machine à
feu ...". Parle t'il des essais de novembre ?
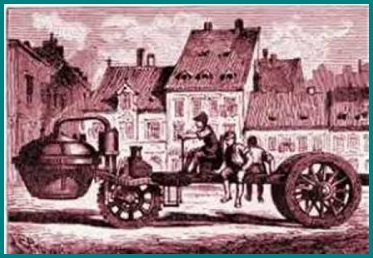
Accident

A ce stade de l'histoire, deux hypothèses sont alors à étudier. Avant cela,
notons que nous nommerons la première machine le "petit fardier", puisque plus
petit que la maquette originelle de Cugnot. D'après les écrits, le Fardier
aurait eu un accident, mais les dates de cet incident restent à définir, les
versions sont différentes selon les témoignages. Examinons les deux possibilités.
Construit à l'Arsenal de Paris sous la direction de Gribeauval,
le Fardier disposait de 2 cylindres et les pistons avaient un mouvement alternatif qui
agissaient sur l'unique roue avant directrice. L'ensemble chaudière-direction était
également à l'avant et l'absence de poids à l'arrière rendait l'engin instable. D'ailleurs, lors des essais
en novembre, Cugnot en perdra le contrôle et le fardier termine sa course dans un mur de l'Arsenal,
suite à un virage mal négocié.
Selon la première version, cet incident empêchera sa mise en
service ultérieure. Là encore, deux solutions sont à étudier. Soit le fardier à
été réparé, soit un deuxième Fardier a été construit pour la présentation
d'avril 1770. Le doute demeure encore car d'autres parlent d'une mise en
chantier d'un Fardier en avril 1770. Etant donné que personne ne parle de
l'existence de trois Fardier, nous sommes dans le flou. Pourtant, en ce qui
concerne les essais, et avant l'accident s'il a eu lieu, le fardier
aurait atteint la vitesse de 4 km/h malgré ses 4 tonnes. Rolland écrira plus tard : "Chargée de 4 personnes, elle aurait parcouru
environ 1,949 mètres si elle n'avait pas éprouvé d'interruption". Le mot
"interruption peut nous faire penser à un accident, mais pourrait aussi vouloir dire
que la chaudière n'était plus en état de faire fonctionner l'engin.
Hypothèse 2
Si on examine la seconde version, c'est le 22 avril 1770, au cours de la présentation
organisée devant le roi Louis XV et la Cour, dans le parc du Prince de Conti, à Vanves,
que l'incident aurait eu lieu. Cette affirmation, différente de la première version, provient des
écrits de A. de Bast parus en 1851. Dans ses notes, il raconte que c'est au cours de cet essai que le mur fut renversé
par le fardier. Ce fait n'a jamais été confirmé par d'autres écrits.
Ce qu'on sait par contre, c'est qu'une somme de 20.000 livres fut attribué à
Cugnot et Gribeauval pour la construction d'un nouveau Fardier.
Au vu de ces deux cas, on peut envisager plusieurs solutions.
Toujours selon les écrits de A. de Bast, le Fardier aurait été réparé et de
nouveaux essais demandés en juillet 1771 (2 juillet 1771). On peut supposer alors que l'accident
a bien eu lieu devant le roi en avril 1770 et que Gribauval a utilisé les 20.000
livres pour réparer le Fardier n° 2.
Ce qui expliquerait également pourquoi Gribeauval commanda, le 21 avril 1770, des pompes
à Strasbourg s'il n'avait pas eu d'accident. Mais on peut aussi imaginer que les
essais eurent lieu avec le petit Fardier, neuf ou réparé après l'accident de
1770 et que le nouveau Fardier, comme le stipule d'autres écrits, que les
travaux débutèrent après la présentation du 21 avril.
Le courrier de Gribeauval
Des écrits laissent encore planer le doute.
Le second Fardier (celui du Musée des Arts et Métiers) est doté d'une mécanique
à deux cylindres, et d'une chaudière qui possède son propre foyer. Construit à
l'Arsenal de Paris (en 1769 ou 1770 selon les versions), sous la direction de Cugnot,
et avec l'aide de Brezin, il est plus grand que le premier engin construit,
dénommé aussi "petit Fardier". Pour le construire, de Gribeauval commanda les
pompes (cylindres et pistons) à Strasbourg.
Un courrier confirme cette commande. Datée du
23 avril 1770, elle est adressée à M. de Chateaufer, directeur de l'Arsenal de
Strasbourg et contient
ces quelques mots : "Il est nécessaire,
Monsieur, qu'aussitôt que ma lettre vous sera parvenue, vous fassiez exécuter à
la fonderie de Strasbourg deux pompes de 14 pouces de longueur intérieure (378
mm) et de 12 pouces de diamètre aussi intérieur (325 mm) et de 4 lignes
d'épaisseur (9 mm), le tout conformément au dessin que vous trouverez ci-joint.
Lorsque ces pompes et ces pistons seront prêts, vous les remettrez au
commissaire du sieur Betrix pour les faire passer sans perte de temps au sieur
Mazuriez, garde-magasin d'artillerie à l'Arsenal de Paris ...".
Rien ne stipule malheureusement si cette commande est passée pour réparer le Fardier ou tout simplement pour en construire
un second. Une chose est sûre, c'est que Gribeauval, une fois la somme de 20.000
livres acquise, et deux jours après les essais, s'est empressé de mettre
en route le chantier.
Après 1771
Si la nouvelle série d'essais fut prévue en juillet 1771, on ne peut affirmer qu'ils eurent lieu. Certains disent que
ces derniers se sont déroulés à Meudon, d'autres entre Paris et Vincennes, comme en 1770.
D'après le calendrier historique, Choiseul a perdu son ministère le 24 décembre 1770. Gribeauval,
lui, est tombé en disgrâce, et sera remplacé à la direction de l'Arsenal.
Du coup, en 1771, le Fardier de Cugnot n'a pas la côte et s'il
bénéficiait du soutien des milieux scientifiques et des officiers d'artillerie, le nouveau ministère
en jugera autrement, ainsi que le général Marquis de Saint-Auban, maréchal de camp d'artillerie,
qui fut l'un des farouches adversaires du Fardier. Dans une lettre qu'il a écrit le 12 mars 1779,
et qui sera publiée dans le "Journal militaire et politique" du 1er mai 1779, Saint-Auban parle d'essais entre Paris
et Vincennes. Ce qui écarterai la version Meudon de 1771, Vincennes étant la
ville la plus proche de l'Arsenal.
Autre adversaire, le successeur de Choiseul. Le Marquis de Montaynard, partisan des anciennes méthodes
qui, une fois en poste, va envoyer le fardier au fond d'un hangar de
l'Arsenal, ou il est voué à l'oubli. C'est là qu'il dormira pendant plusieurs années.
Suite à ces faits, Cugnot arrête ses recherches. A la
révolution, il partira trouver refuge à Bruxelles et ne reviendra en France
qu'à l'avènement de Bonaparte. Il recevra alors une pension de 1.000 francs du
Premier Consul, pension qui va lui permettre de vivre jusqu'à sa mort en 1804.
Quant au fardier, L. N. Rolland, Commissaire général de l'artillerie, le sauvera
par deux fois de la destruction, suite aux décisions du Comité Révolutionnaire en
1793 et du ministre Dubois Grance en 1797. Bonaparte, officier d'artillerie, marqua de l'intérêt pour le
fardier, mais la campagne d'Egypte en 1798, et l'âge avancé de Cugnot (75 ans)
font capoter le projet. Bonaparte accordera cependant une pension de 4.000
livres à Cugnot, somme qui le fera vivre jusqu'à son décès en 1804.
Suite à la demande de
Mr Mollard, conservateur des Arts et Métiers nouvellement créés en 1799, le fardier
lui sera confié en 1800/1801. Grâce à lui, on peut encore l'admirer aujourd'hui.
Certains techniciens et historiens doutèrent de
l'authenticité du fardier. De récentes études ont pourtant établi que ce
dernier avait bel et bien fonctionné. Les plus sceptiques évoquent alors le fait
qu'il était impossible de brûler du charbon dans le foyer de la machine. En
réponse, on signalera qu'il était alors fort possible d'y faire brûler du bois,
de le faire fonctionner sur une courte distance, et c'est sûrement ainsi que l'inventeur procéda à l'époque.

Une autre version...
L'histoire du fardier est très floue et comme nous l'avons vu, très difficile à raconter,
les différents écrits ne permettant pas de situer véritablement les faits et les dates.
la version ci-dessous vient encore embrouiller les choses.
Le début de l'histoire correspond à la précédente. Planta se retire et Gribeauval demande à Cugnot de terminer
le premier Fardier, aux frais de l'état; Des essais ont alors lieu en 1769. Après ces essais, Cugnot recevra
l'ordre d'en construire un deuxième, avec une dotation du roi de 20.000 livres. Ce deuxième Fardier serait
construit vers la fin de 1770.
A ce stade, on peut dire deux chose. La présentation devant la cour a bien été réalisée en avril 1770
puisque Gribeauval et Cugnot dispose de la somme de 20.000 livres. Que c'est le premier Fardier qui fut présenté
à cette occasion. C'est donc lui qui aurait eu l'accident, et non le fardier n° 2.
Poursuivons...
La fonderie de Strasbourg ne peut pas livrer dans les temps la commande de Gribeauval et c'est avec
le petit fardier, le premier, que les essais se poursuivent. Le fardier 2 ne sera prêt qu'en 1771 et ne sera pas testé,
Gribeauval et Choiseul n'étant plus présents dans l'aventure. D'après cette version encore, on aurait perdu la trace
du petit fardier et celui qui est inachevé, le n° 2, est mis en quarantaine. C'est ce dernier qui sera restauré en 1900
pour l'exposition universelle. Ce qui expliquerait son état presque neuf lorsqu'on le voit au musée des Arts et Métiers
de Paris ou il est exposé. Certains ingénieurs, après avoir étudié la chaudière, affirment
que le Fardier, tel qu'il est exposé, n'a pas pu fonctionner, d'autres pensent qu'il y a une possibilité de le faire,
sur une courte distance, ce qui confirme les essais chaotiques décrits dans le récit précédent.
En résumé, aujourd'hui encore, le fardier garde son secret et posera encore plus de questions qu'il n'en
résoudra, que ce soit sur sa construction, son fonctionnement ou son utilisation.